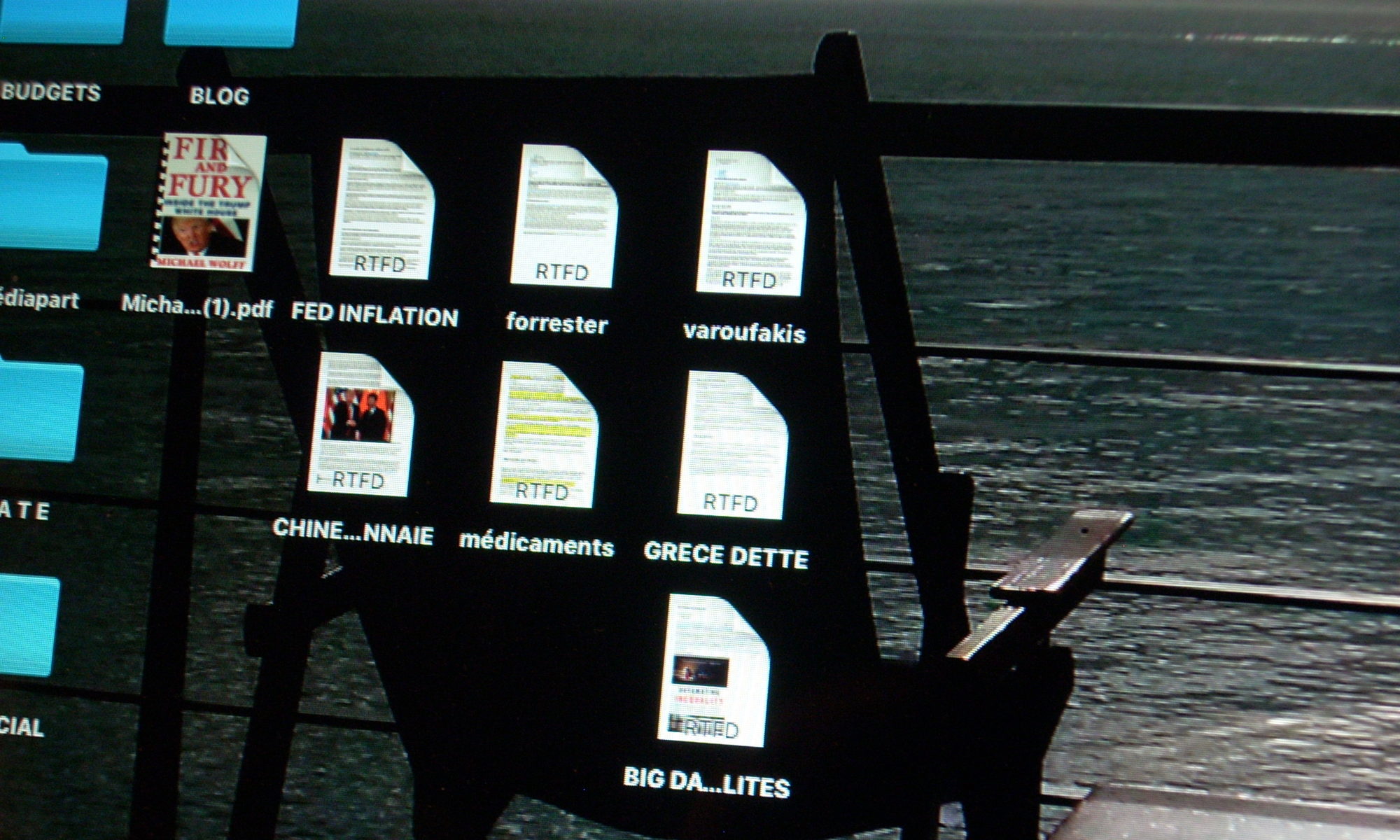Jusqu’où les robots remplaceront-ils les humains ? Le débat n’est plus aussi vivace, mais il rebondira. La place prise sur les marchés par les robots du trading à haute fréquence (THF) a en attendant de quoi faire réfléchir.
Une martingale pour les paris financiers
LA MAIN ÉLECTRONIQUE DES MARCHÉS, par François Leclerc
L’INSTABILITÉ FINANCIÈRE A SES RAISONS QUE L’ON NE CONNAIT PAS, par François Leclerc
LES BANQUES, LE RETOUR, par François Leclerc
QUEL MONDE ! NON MAIS QUEL MONDE ! par François Leclerc
Billet invité.
Jadis, les banques centrales faisaient le marché, gendarmes respectés du système financier, que la puissance publique contrôlait. Aujourd’hui, que maitrisent-elles vraiment, du haut de leur indépendance de façade ? Les faits semblent désormais établis : leurs moyens ne sont ni dimensionnés ni adéquats au regard de ce qu’est devenu un monde qui leur échappe. Les mouvements de capitaux sont disproportionnés par rapport à ce qu’elles peuvent mobiliser, et leurs instruments de politique monétaire sont sans prise sur une crise multiforme.
Dans ce nouveau monde, le gigantisme atteint par les institutions financières porte à réflexion. Selon SNL Financial … Lire la suite
Permissives contraintes financières : LA VOIE EST LIBRE ! , par François Leclerc
Billet invité
En prologue de son analyse des bilans de 128 banques européennes, la BCE vient comme prévu de calmer le jeu, confirmant qu’elle entend aborder ce périlleux exercice non sans complaisance. Dévoiler la réalité, c’est replonger l’Europe dans une crise aiguë, trop la masquer c’est perdre toute crédibilité.
Dans une lettre à Sharon Bowles, la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, Mario Draghi donne des assurances à propos du traitement réservé aux obligations souveraines. Elles ne feront l’objet d’aucune dépréciation lors de l’examen, à la seule condition que les banques aient prévu de … Lire la suite